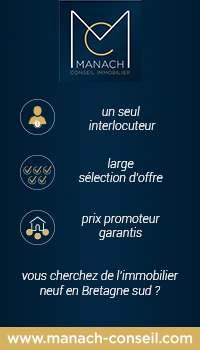"Oui! I faut oser. Être un peu précurseur. Initier les choses"
Publié le 17 Juillet 2025 par Ouest Immobilier Neuf

Vous prévoyez le futur achat d'un appartement neuf dans tout le Grand Ouest, de Brest à Paris ou encore de Caen à Bordeaux, en passant par Rennes, Vannes, Nantes...? Promoteurs, Experts, Observatoires du Logement...
Chaque mois OIN donne la parole à celles et ceux qui bâtissent sur les territoires. Sans rien céder sur leur engagement même en cette période !
|
26 juin 2025... Nouvelle résidence « Palmira »: le Groupe Gambetta dévoile 59 nouveaux logements dans la périphérie de Nantes
27 juin 2025... Le Groupe Gambetta inaugure « INAË », une résidence de 50 logements neufs en accession libre et en BRS
Parce que cela fait "du bien" de voir qu'en cette fin de 1er semestre, alors que le marché de l'immobilier est toujours "sous tension" - entre des ménages qui peinent à reprendre le chemin des banques, sans doute découragés... des investisseurs qui ont déserté ... et des prix qui restent en décalage avec le salaire médian de certains territoires; d'où la pertinence de modèles bien pensés ! - nous avons choisi d'aller à la rencontre ce mois-ci de Julien Boillaud, Directeur de l’agence Gambetta Nantes.
Accession abordable, dispositif BRS, logique de mixité renforcée, travail partenarial renforcé avec les collectivités...
"Notre modèle a pu paraître en retrait, parfois moins visible, avec une production jugée marginale. Et pourtant, nous étions là" rappelle le Directeur
Déjà et plus que jamais présentement. Illustration !
|
Ouest Immobilier Neuf
Promotion immobilière... Certes, le climat reste en cette fin de premier semestre toujours aussi tendu dans un marché quasi atone. Pour autant, saluons les réussites : des programmes sortent encore de terre ! Et c’est précisément votre cas. A mettre au crédit de votre statut de coopérative ?
Julien Boillaud
Tout à fait ! Heureusement que certaines dynamiques continuent à exister. Cela tient sans doute au fait que notre positionnement diffère de celui de la promotion privée. En tant que coopérative, nous portons un regard singulier sur le territoire et jouons un rôle... un peu à part.
D’une certaine manière, je considère que nous sommes des producteurs de logements “contra-cycliques”. Contrairement aux logiques de marché classiques, nous intervenons sur le segment de l’accession abordable, en particulier grâce au dispositif BRS, qui permet la dissociation entre le foncier et le bâti.
Nous avons d’ailleurs fortement amplifié notre production sur ce modèle, qui reste résilient dans un contexte économique tendu. C’est précisément là où nous prenons, sans doute, le contre-pied de la promotion privée.
Cette dernière s’est longtemps appuyée sur la vente en bloc à des investisseurs, très dépendante de dispositifs fiscaux et de conditions de financement historiquement favorables - des taux d’intérêt bas, aujourd’hui disparus.
Pendant cette période, notre modèle a pu paraître en retrait, parfois moins visible, avec une production jugée marginale. Et pourtant, nous étions là.
Aujourd’hui, alors que la production globale chute fortement, notre approche prend une place croissante sur le marché. Cela montre bien qu’il n’y a pas que l’investisseur privé. Il reste indispensable, certes, mais d’autres modèles existent.
Et nous avons prouvé que nous savons aller chercher une clientèle souvent délaissée par la promotion classique, avec des produits adaptés à ses attentes et à ses capacités réelles de financement.
OIN
De quoi jouer un rôle stratégique dans cette relance ciblée de la construction...
Julien Boillaud
Exactement. Même si cette fin de premier semestre reste néanmoins marquée par une situation immobilière très dégradée. Quand on regarde les chiffres dont on dispose, on voit que 2025 s'amorce presque comme 2024, voire pire ! On ne s'attend pas à un rebond sur le deuxième semestre. Dans ce jeu particulier, en tout cas sur la région Pays de la Loire, c'est particulièrement marqué. D’où cette question plus que jamais d‘actualité pour l’acteur que nous sommes : comment aujourd'hui arriver à trouver les leviers d'action en vue de continuer à produire du logement là où on a vraiment besoin?
.jpg)
© Groupe Gambetta
OIN
De quoi évoquer votre programme INAE, 50 logements neufs en accession libre et en BRS inauguré ce printemps en présence de Bertrand Affilé, maire de Saint-Herblain,et David Martineau, conseiller départemental. Dans mon interview précédente, l’aménageur rencontré insistait sur la façon dont aucun acteur ne peut aujourd'hui travailler seul dans son coin. Plus que jamais, collectivités et promoteurs doivent avancer dans un démarche “ gagnant-gagnant". Autrement dit: travailler en intelligence ?
Julien Boillaud
Tout à fait, même si j’ai envie de dire que ce n’est pas vraiment nouveau. Cela dit, c’est de plus en plus vrai que nous devons travailler en synergie, tout en évoluant parallèlement. Pour ma part, j’ai toujours considéré que notre métier s’apparente à celui d’un “ensemblier” : nous coordonnons l’ensemble des expertises nécessaires pour parvenir à produire du logement.
Cela s’avère d’autant plus vrai lorsque le marché se tend. Aujourd’hui, notamment au regard des objectifs liés au BRS, il serait totalement illusoire d’envisager une opération sans le soutien actif des collectivités, qu’il s’agisse du Département, de Nantes Métropole ou des communes. Le travail d’analyse s’est considérablement affiné : désormais, l’analyse commerciale est partagée, ce qui signifie que les difficultés comme les réussites sont discutées et mises en commun. Avec bien des questions:
Qu'est-ce qui s'est vendu ? Pourquoi n'a-t-on pas réussi à le vendre ? Quels sont les effets de blocage ? On avait pris une hypothèse, elle ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment peut-on aider ? Trouver d'autres leviers pour arriver à fonctionner et aboutir ?
C’est une évolution assez récente dans notre manière de collaborer avec les collectivités, mais elle s’impose comme une nécessité : il faut désormais partager aussi les difficultés rencontrées. Lorsque tout se vendait facilement, la question ne se posait pas. À l’époque, les collectivités se concentraient davantage sur les enjeux d’urbanisation, d’intégration dans le tissu urbain, ou encore sur le traitement des détails architecturaux, etc..
Bien sûr, cela continue, c’est une évidence. Mais nous sommes désormais entrés dans une nouvelle phase : celle où l’on va beaucoup plus loin dans l’analyse, en s’intéressant notamment à la composition des familles. Quels niveaux de revenus peut-on réellement cibler aujourd’hui ? Ces familles sont-elles réellement présentes sur le territoire ?
Prenons INAE, par exemple: nous avions fait le pari de grands logements, type 3, type 4, type 5, en se disant on va aller chercher des familles. Ça n'a pas été simple...
OIN
Car il faut les sortir du modèle bien ancré de la maison avec jardin?
Julien Boillaud
Exactement. Au final, tout s’est vendu, même si les délais ont parfois été longs. Il faut dire qu’il est nécessaire d’accompagner les acquéreurs pour les faire évoluer d’une vision traditionnelle du logement - celle de la maison individuelle avec 300 m² de jardin - vers d’autres formes d’habitat.
Un autre enjeu majeur est la solvabilisation des ménages : plus le logement est spacieux, plus son prix est élevé, ce qui est logique. Il nous faut donc identifier des familles en capacité de financer un achat aujourd’hui, même si les taux d’intérêt, désormais stabilisés, représentent une amélioration.
Sur ce point précis, je ne pense pas que les taux vont baisser, mais leur stabilité est déjà un signal positif. D’autant plus que certaines banques et établissements financiers, comme le Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel - tous deux membres de l’OFS sur l’arc atlantique - considèrent essentiel de soutenir ce type de financement.
Les acteurs jouent réellement le jeu ! Lorsqu’on parvient à réunir autour de la table les collectivités, les établissements financiers et les opérateurs, c’est l’ensemble du dispositif qui se met en place : on cherche ensemble, et on parvient à trouver des solutions concrètes, voire à en faire émerger de nouvelles.
Un exemple très parlant : nous avons expérimenté un produit au format un peu atypique, le T2-BIS. Ce n’est ni un T2 classique, ni un véritable T3, mais un logement intermédiaire, d’environ 50 m². Et le succès commercial a été au rendez-vous.
Pourquoi "BIS" ? Parce qu’il s’agit d’un T2 enrichi d’une petite pièce supplémentaire, équipée d’une paroi coulissante, qui peut se fermer ou non selon les besoins. Cette pièce apporte une certaine intimité et peut faire office de bureau, de chambre d’enfant ou d’espace d’accueil ponctuel.
Ce format a parfaitement trouvé sa place sur le marché, notamment parce qu’il offrait un prix très ajusté, en cohérence avec les plafonds de ressources et les capacités de financement des ménages ciblés.
Il répond aussi à une nouvelle demande post-Covid, que nous ne constations pas auparavant : celle des familles monoparentales, en forte progression - elles représentent aujourd’hui près de 14 % des ménages selon l’INSEE - qui, en raison de parcours de vie parfois complexes, n’ont pas encore les moyens d’accéder à un T3.
OIN
De quoi dire aussi que via le BRS, l’accession à tel ou tel type d’appartement peut n’être qu’une étape dans le parcours résidentiel...
Julien Boillaud
C’est exactement cela : certains acquéreurs choisissent un type 4 parce qu’ils s’y projettent à long terme et s’y sentent bien.
Mais pour d’autres, le logement peut aussi représenter une étape de vie, un tremplin. La réflexion est alors la suivante : “Je ne peux pas m’offrir un type 3 de 65 à 70 m² à 190 000 euros, mais un T2 bis de 55 m², à 130 000 euros, cela devient envisageable.”
L’écart de 20 000 à 60 000 euros selon les cas, ce n’est pas anodin : cela représente jusqu’à cinq années d’annuités de remboursement sur un prêt immobilier !
Ce type de positionnement répond donc très clairement à une attente contemporaine. Ce qui est intéressant, c’est que le programme INAE a été conçu avant la crise du Covid, à une époque où l’on ne percevait pas encore l’émergence de cette typologie de clientèle. Aujourd’hui, les choses ont évolué, et cette demande est bien réelle. C’est pourquoi j’intègre désormais de manière systématique une part plus importante de T2 bis dans les projets, alors que ce type de configuration n’existait pas dans nos programmations précédentes.
.jpg)
© Groupe Gambetta
OIN
Et puis je vois qu'en plus, vous ne vous interdisez pas une résidence qui adopte une architecture “ciselée, moderne”. Très classe ce programme INAE...
Julien Boillaud
Merci ! Mais ce que cela illustre surtout, c’est que le BRS (Bail Réel Solidaire) ne relève en rien d’un mécanisme de dumping social. Si les logements sont proposés à des prix maîtrisés, c’est parce que plusieurs leviers puissants sont mobilisés.
Le premier, bien sûr, repose sur la dissociation entre le foncier et le bâti, qui permet de réaliser une économie substantielle. Le second tient à l’implication directe de la métropole nantaise, qui garantit une exigence de qualité architecturale.
En comparant les différents modèles d’OFS en France, on constate que notre configuration est assez unique : ici, la collectivité est pleinement partie prenante de l’OFS. Et par “collectivité”, j’entends bien sûr Nantes Métropole, mais aussi d’autres communauté de communes tel que Pornic Agglo ou la CARENE, et également le Département.
Ce qui rend ce type d’opération particulièrement vertueux, c’est qu’elle articule à la fois du logement libre et du BRS, dans une logique de mixité réelle dès le palier. Il n’y a pas d’un côté une “cage BRS” et de l’autre une “cage libre”.
Pour m’en assurer, je suis allé rencontrer les résidents, six mois après leur emménagement, afin de recueillir leurs ressentis. Et le retour a été unanime : que des éloges. Cela fait sincèrement chaud au cœur. Je les ai même mis au défi de me dire qui, parmi leurs voisins, avait acheté en BRS ou en libre... aucun n’a su répondre, et c’est exactement ce que nous recherchions.
Il n’y a aucune différence de traitement, ni en termes de prestation, ni en termes de qualité architecturale. Cette dernière reste un vecteur essentiel d’appropriation et de valorisation du logement.
Car un acquéreur BRS est un acheteur à part entière. Il finance, il mobilise des fonds propres, parfois en s’endettant jusqu’à 33 voire 35 % de ses revenus. C’est un engagement fort. Et lorsqu’on investit de manière aussi significative dans un bien, on souhaite naturellement que la résidence reflète un cadre de vie agréable, soigné et valorisant. C’est une attente légitime.
OIN
Un type de programme “hybride” plus que jamais dans votre ADN ?
Julien Boillaud
Cela a toujours été dans notre ADN et cette conviction est plus que jamais renforcée en 2025. C’est une direction évidente, naturelle, dans laquelle nous sommes engagés depuis longtemps. La question ne s’est même pas posée, car cela fait plus de 100 ans que nous sommes implantés sur la Région Pays de La Loire en Loire-Atlantique, et que nous sommes pionniers en matière de mixité au palier dans nos opérations.
À l’époque déjà, avec le PSLA - bien avant l’émergence du BRS - nous proposions des opérations mêlant locatif social, logement libre et accession abordable, y compris via un patrimoine locatif que nous gérons encore aujourd’hui. Nous avons toujours refusé de segmenter nos résidences par cage ou par statut d’occupation.
Bien sûr, cela suppose de lever certains freins à la commercialisation. Il arrive encore qu’un acquéreur exprime des réticences : « Mais enfin, j’achète un logement, et vous me dites qu’en face, il y aura du locatif social ? Ça risque d’être compliqué… »
Et notre réponse est claire : Non, cela ne pose aucun problème. D’abord, parce que nous restons souvent bailleur des logements en face, ce qui signifie que nous connaissons nos locataires. Ensuite, il suffit de venir constater sur le terrain : les résidences que nous avons livrées fonctionnent très bien, souvent mieux que celles où les statuts sont compartimentés.
Pourquoi ? Parce que la mixité crée de la vigilance partagée. Quand on sort de chez soi et que l’on voit une ampoule grillée sur le palier, le propriétaire occupant va remonter l’information. Le locataire ne le fera peut-être pas, mais cette cohabitation produit une dynamique d’entretien et de qualité de vie bien supérieure à celle des bâtiments cloisonnés.
Et puis, il faut avoir en tête un chiffre essentiel : 70 % de la population est aujourd’hui éligible au logement social. Quand on regarde les plafonds de ressources en PLUS ou en PLS, on réalise que la majorité des ménages pourraient potentiellement y prétendre. Cela permet de relativiser certaines craintes et de remettre en perspective la notion même de mixité.
OIN
Vous évoquiez la mixité, d'où une transition sur l'autre programme qui a retenu mon attention, PALMIRA au profit de la “mixité intergénérationnelle” avec 42 logements en l'accession libre, mais aussi 17 logements inclusifs cédés à Habitat et Humanisme...
(1).jpg)
© MyPhotoAgency
Julien Boillaud
Avec le projet Palmira, nous avons souhaité aller encore un peu plus loin dans cette logique de mixité renforcée. L’idée a germé à partir d’une précédente expérience menée en partenariat avec Habitat et Humanisme, sur le programme situé allée Baco, face au château et à proximité immédiate de la gare de Nantes.
Dans cette opération, nous avions conçu une résidence intergénérationnelle de 46 logements, principalement de petites surfaces, avec un objectif clair : répondre à des besoins spécifiques de publics en situation de précarité résidentielle. Habitat et Humanisme avait notamment travaillé avec le centre de formation des apprentis en coiffure, pour loger de jeunes alternants, souvent sans solution d’hébergement pendant leur formation ou leur stage au CHU de Nantes
.
Le dispositif s’adressait également à des personnes souffrant d’anorexie sans logement, ou encore à des femmes accompagnées d’enfants, confrontées à des situations familiales difficiles, voire à des ruptures brutales.
Nous avions ainsi conçu une résidence “tremplin”, pensée pour une durée d’accueil de un à deux ans, permettant aux résidents de retrouver une stabilité, un cadre de vie sécurisant et de se réinsérer progressivement dans un parcours résidentiel plus classique.
Ce projet s’est révélé particulièrement riche humainement, avec une salle commune et la présence d’un animateur de vie sociale, salarié sur place, qui proposait de nombreuses activités : ateliers cuisine, théâtre, lecture, projections de films, événements ouverts à la résidence mais aussi au quartier.
L’expérience a été un véritable succès, tant en matière de vivre-ensemble que de rayonnement local. Les retours des habitants ont été extrêmement positifs, et c’est ce qui nous a amenés à réfléchir : pourquoi cantonner ce type de dispositif à une résidence isolée ? Pourquoi ne pas l’intégrer au sein d’un programme plus large, mêlant également logement libre et habitat traditionnel ?
C’est ainsi qu’est née l’idée de Palmira, sur un site particulièrement adapté, car accueillant également un IME géré par l’ADAPEI des Pays de la Loire, qui reçoit des enfants, en journée comme en nuitée, atteints de handicaps plus ou moins lourds.
Nous avons alors imaginé une résidence véritablement mixte, réunissant :
– des logements réservés à des publics identifiés en amont ;
– des logements en accession libre ou en investissement locatif ;
– des résidences principales plus classiques.
Le pari est simple : construire un lieu de vie inclusif, dans lequel cohabitent des profils variés, autour d’un projet commun, humain et durable.
OIN
C’est louable et vertueux mais risqué aussi non ? Mélanger ainsi les publics ...
Julien Boillaud
Exactement… à ceci près que l’accueil a été extrêmement positif ! Bien sûr, nous nous sommes posé la question : « Est-ce que la mayonnaise va prendre ? » Et finalement, dans les échanges avec nos clients, nous avons constaté que ce dispositif a été un véritable vecteur d’appropriation.
Ce n’était peut-être pas un élément déclencheur direct de l’acte d’achat ou de réservation, mais cela a incontestablement suscité une adhésion forte. Beaucoup nous ont dit : « Mais c’est génial, en fait ! »
D’autant que, dans la manière dont les logements sont répartis dans l’ensemble de la résidence, on ne peut pas identifier qui occupe quoi. Les logements dits “inclusifs” sont occupés indistinctement par des personnes en situation de handicap mais relativement autonomes, des seniors, ou encore des étudiants, que l’on qualifie un peu de “sentinelles” : des jeunes présents en contrat de location d’un an, qui participent à la veille du bon fonctionnement de la résidence, alertent en cas de dysfonctionnements, etc.
Et surtout, la résidence intègre une salle commune animée par un professionnel de la vie sociale, dont les activités bénéficient à tous les habitants, pas uniquement aux logements inclusifs. J’ai eu l’occasion d’échanger avec l’animatrice en poste il y a une quinzaine de jours : « ça cartonne ! », m’a-t-elle dit. On voyait les petits mots accrochés sur les murs, les plats mitonnés dans la cuisine partagée… une vraie vie collective !
Ce succès tient à deux éléments essentiels :
– Premièrement, pour les acquéreurs en accession, il n’y a aucun surcoût : le prix du logement reste inchangé. La salle commune, sa gestion et ses animations ne génèrent aucun coût supplémentaire, ce qui rassure ceux qui pourraient craindre de financer un service dont ils n’auraient pas l’usage. Pour les propriétaires occupants comme pour les investisseurs, c’est un “plus” pour la résidence, un atout de valorisation sans contrepartie financière.
– Deuxièmement, il y a cette chance inouïe d’avoir une présence humaine permanente, incarnée par un salarié associatif qui crée du lien, anime la résidence, organise des rencontres, des fêtes, des ateliers… Un peu comme un super gardien, mais avec une vraie vocation sociale et collective.
(1).jpg)
© MyPhotoAgency
OIN
j'ai l'impression que vous réussissez ici ce qui est si difficile au niveau des municipalités, comme si en tant que coopérative, à la façon d’un microcosme, vous aviez trouvé la solution : faire s’entendre les gens ! Alors qu’on ne parle que de fracture...
Julien Boillaud
Je n’ai pas la prétention d’avoir trouvé la recette parfaite... l’avenir nous le dira. Quoi qu’il en soit, c’est un essai, une tentative, avec l’envie de faire bouger les lignes.
Vous savez, favoriser la rencontre entre les habitants, les aider à se familiariser les uns avec les autres, cela repose aussi sur des choix architecturaux concrets. Sur le programme INAE, nous avons fait le pari de très petits paliers. La résidence compte 50 logements, mais répartis sur trois cages d’escalier, avec très peu d’appartements par palier. C’est un choix assumé, qui a un coût, mais qui crée des conditions propices aux échanges.
Quand vous avez un couloir de 20 mètres de long, les gens se croisent, se disent bonjour, et ça s’arrête là. En revanche, ouvrir sa porte sur un palier de 4 m², se retrouver à attendre l’ascenseur à côté d’un voisin, ou arriver avec un pack d’eau dans les bras, ce sont autant d’occasions de créer du lien, d’entendre : « Vous avez besoin d’un coup de main ? »
Oui, il faut oser. Être un peu précurseur. Initier les choses. Bien sûr, tout ne fonctionne pas. Par exemple, imposer des espaces partagés dès la conception, sans laisser le temps aux usages d’émerger, peut être contre-productif. Même bien intentionnées, les démarches trop descendantes ne prennent pas toujours.
Beaucoup de tentatives ont été faites. Certaines ont échoué. Il faut savoir le reconnaître, ajuster, corriger. Et surtout se dire que la dynamique doit venir de l’habitant, de celui qui s’approprie le lieu et choisit, en temps voulu, d’investir du sens dans son cadre de vie.
Un exemple récent m’a particulièrement marqué : un propriétaire m’a dit « On vient de créer un groupe WhatsApp de la résidence pour échanger entre nous. Et on a aménagé, derrière l’immeuble, un espace de rencontre avec un terrain de pétanque. On organise notre premier tournoi vendredi soir ! »
Et là, je me suis dit : « C’est gagné. »
Vous aimerez aussi :
 18 Juillet 2025
18 Juillet 2025
 11 Juillet 2025
11 Juillet 2025
 29 Juin 2025
29 Juin 2025
 30 Juin 2025
30 Juin 2025



.jpg)
.jpg)
(1).jpg)
(1).jpg)